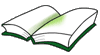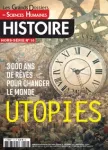| Titre : | Les utopies (Dossier) (2021) |
| Auteurs : | Laurent TESTOT, Auteur |
| Type de document : | Article |
| Dans : | Les Grands Dossiers des Sciences Humaines (HS n° 10, Décembre 2021 - Janvier 2022) |
| Article en page(s) : | 77 p. |
| Catégories : |
[Prisme] UTOPIE [Prisme] DEFINITION [Prisme] LITTERATURE [Prisme] SOCIOLOGIE [Prisme] PHILOSOPHIE [Prisme] QUALITE DE LA VIE [Prisme] ETAT [Prisme] CROISSANCE ECONOMIQUE [Prisme] RELIGION [Prisme] REVOLUTION [Prisme] MILITANTISME [Prisme] EMANCIPATION [Prisme] INEGALITE [Prisme] APPROCHE HISTORIQUE |
| Résumé : |
Quand il rédigea Utopia en 1516, Thomas More changea le monde pour les siècles à venir : un demi-millénaire s’est écoulé, et son idée nourrit toujours les luttes politiques.
Son livre comportait deux parties : une première pour dresser le constat des injustices et des violences souffertes par l’humanité ; une seconde pour dépeindre un pays libéré de ces souillures, Utopia, littéralement non-lieu. Une contrée présentée comme fictive, mais si réaliste qu’elle semblait à portée de main. Se projeter en imagination dans un univers idéal afin de baliser la voie qui permettra d’améliorer demain le monde… L’utopie est un outil d’émancipation. Un siècle après T. More, son compatriote Roger Bacon décrivit un monde régi par un dictateur, conseillé de savants, qui ressemble furieusement à celui dans lequel nous entrons. Entre-temps, Rabelais avait posé un autre idéal : celui d’une abbaye où chacun vivrait dans la plus parfaite des libertés. Les rêves entraient en concurrence. Cette rivalité démontrait aussi que l’utopie est une arme à double tranchant. Les utopies, au fil de l’histoire, ont toujours puisé leur force dans la tension entre ce qui était souhaitable et ce qui pouvait dysfonctionner. Au milieu du 19e siècle, Marx et Engels faisaient de la dictature du prolétariat un rêve, que Staline et Mao se chargèrent au 20e siècle de transformer en cauchemar. Mais l’utopie survécut à ces instrumentalisations et à ces errances. Aujourd’hui, politiques et philanthropes n’hésitent pas à nous promettre un avenir vert et prospère, quand des écrivains et des militants les accusent de préparer des lendemains dystopiques – ceux-là revendiquent l’utopie comme résistance. Toujours combattues, éternellement diffamées comme irréalistes, les utopies continuent d’irriguer les imaginaires à la source des combats politiques. C’est ce qu’avait compris Thomas More : la puissance de l’utopie vient de ce qu’elle est un récit partagé. On ne peut pas empêcher un humain de rêver à un monde meilleur, et l’utopie est à même de canaliser cette énergie en rêve partagé. Bienvenue dans cette histoire des mondes meilleurs, à faire collectivement advenir… d’urgence ! (Présentation éditeur) |
| Note de contenu : |
p. 6 - Les utopies
p. 25 - Les rêves modernes p. 55 - Demain le paradis ? |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| IRTS106455 | - | [Revue] | CRD IRTS Normandie-Caen | [Revue] | Disponible |